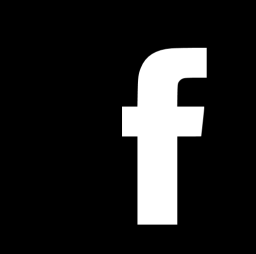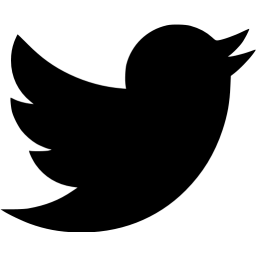Mesures de réforme et de modernisation ferroviaire
- Réunifier la gestion des infrastructures (RFF et SNCF) par le biais d'une holding, comme en Allemagne.
- Lignes à grandes vitesses : honorer les projets de LGV en cours [LGV Est, Tours-Bordeaux, Bretagne-Pays-de-la-Loire, ndlr] et les 1 000 kilomètres par an de voies ferrées à moderniser. Pour les nouveaux projets, analyser leur utilité sociale en amont, et se tourner du côté des subventions européennes pour les financer.
- Réformer et moderniser le fret ferroviaire, en investissant dans du matériel ferroviaire, en améliorerant le raccordement des ports et des aéroports.
- Mise en concurrence des TER : l'ouverture du marché ne pourra se faire qu'à l'initiative des régions et sous forme d'expérimentation.
- Pas de mise en concurrence des trains d'équilibre du territoire (TET) (qui a été préconisée par les Assises du ferroviaire, fin 2011).
- Mettre en place à l'occasion de la libéralisation une convention collective du transport ferroviaire de voyageurs, avec le socle du statut actuel des cheminots.
- Créer des autorités décentralisées pour organiser la mobilité durable dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Leurs compétences : gestion des transports publics, des systèmes d'autopartage, de covoiturage, des vélos en libre-service, du stationnement et de la voirie.
- Créer une ressource fiscale pour les régions : soit par une extension du versement transport (VT) au-delà du périmètre de transport urbain, soit par un versement transport "interstitiel" plafonné.
- Emettre des obligations d'Etat pour alimenter l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), après la remise en concurrence des concessions autoroutières en 2030. La taxe poids lourd et l'Eurovignette 3 alimenteront également l'AFITF.

Promesse partiellement tenue de François Hollande
La réforme ferroviaire
 Une réforme ferroviaire a été adoptée 21 juillet 2014 par le Parlement, malgré une importante grève des cheminots. Elle prévoit :
Une réforme ferroviaire a été adoptée 21 juillet 2014 par le Parlement, malgré une importante grève des cheminots. Elle prévoit :
- La fusion de RFF et de la SNCF dans une société unique divisée en deux branches (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) dont l'Etat est l'actionnaire majoritaire
- La pose de "jalons législatifs" nécéssaires à la construction d'un cadre social commun à tous les travailleurs de la branche ferroviaire
- Un pacte national pour l’avenir du service public ferroviaire, censé stabiliser sa dette d'ici dix ans
- L'extension des pouvoirs de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) : avis conforme sur la nomination du président de SNCF Réseau, avis sur les péages ferroviaires
- La création d'un Haut comité du ferroviaire qui rassemblera élus, régions, entreprises, organisations syndicales et usagers
L’objectif de cette réforme et notamment de la fusion vise à réduire l’énorme dette de 44 milliards d’euros du secteur ferroviaire, qui augmente chaque année de 2 à 3 milliards d'euros.
Les projets LGV
 Le gouvernement a assuré la réalisation des lignes à grande vitesse (LGV) suivantes :
Le gouvernement a assuré la réalisation des lignes à grande vitesse (LGV) suivantes :
- Tours-Bordeaux (prévue pour juillet 2017, avec un concessionnaire privé)
- Le deuxième tronçon de la LGV Est entre Beaudrecourt et Strasbourg (inauguré le 3 juillet 2016)
- La LGV Le Mans-Rennes (prévue pour septembre 2017).
- La LGV Lyon-Turin (travaux commencés en 2016).
Si des doutes portaient sur la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse, le gouvernement a validé en 2015 la réalisation de cette ligne – tout comme le Bordeaux-Dax.
A l’inverse, après un rapport de 2014 de la Cour des Comptes qui dénonçait le "tout-TGV", de nombreux projets ont été mis sur la touche et reportés après 2030 (LGV Dijon-Lyon, Montpellier-Perpignan, ou encore Marseille-Nice).
"Le gouvernement fait un choix. (...) c'est celui de la priorité à la maintenance, c'est celui de la priorité aux trains du quotidien", a justifié Alain Vidalies, le secrétaire d'Etat aux Transports.
La rénovation du fret ferroviaire
 Après la réforme ferroviaire, les entreprises privées du fret (ECR, Colas Rail...) sont montées au créneau. Les groupes privés qui représentent 26 % du marché du fret considéraient que cette réforme était favorable à l'opérateur historique SNCF, réunifié sous la forme d'une holding.
Après la réforme ferroviaire, les entreprises privées du fret (ECR, Colas Rail...) sont montées au créneau. Les groupes privés qui représentent 26 % du marché du fret considéraient que cette réforme était favorable à l'opérateur historique SNCF, réunifié sous la forme d'une holding.
Le fret s’est considérablement affaibli en France, passant 57,7 millions de tonnes en 2000 à 32,1 millions de tonnes en 2009 avant de se stabiliser, selon l’association française du Rail (Afra). Les entreprises appelaient dès 2014 à une rénovation des lignes capillaires, ces petites lignes largement utilisées pour le transport de marchandise mais délaissées par l’Etat depuis plusieurs années.
Au cours des cinq conférences sur la relance du fret ferroviaire, l’Etat s’est engagé à différentes mesures :
- Une ouverture à la concurrence du fret ferroviaire suite à l’application des directives européennes.
- Aides financières à hauteur de 30 millions d'euros pour la rénovation des lignes capillaires de 2015 à 2017, versée à l’Afitf Et le prolongement sur 3 ans (2018/2020) de la contribution pour la pérennisation des lignes capillaires, de l’ordre de 10 millions par an.
- Une incitation à un financement mixte (transporteurs, régions…) de la rénovation des lignes capillaires
- Une hausse des tarifs des péages de fret de 6,27% en 2016 et de 2,4% en 2017, puis sur 10 ans.
- 20M € pour favoriser l’intermodalité sur les grands ports, la création d’autoroutes ferroviaires et l’installation de wagons moins bruyants.
Suite à ces mesures, une croissance du trafic du frêt ferroviaire de 6 % à été observée au premier trimestre 2015. Malgré la réforme, la reprise du fret reste timide. En 2016, les mouvements de cheminots ont ralenti la reprise. De plus, un rapport de l’ARAF pointe les investissements insuffisants de l’Etat pour dynamiser le frêt. En 2014, le ferroviaire ne représentait que 9,8% du transport de marchandises, contre 87,8% pour le routier.
La mise en concurrence des TER
 Si François Hollande a respecté sa promesse de donner l'initiative de la mise en concurrence des TER aux régions, celle-ci pourrait ne pas voir le jour avant un moment. Le 8 octobre 2015, les ministres européens ont fixé à 2026 l’ouverture à la concurrence des TER. A l’issue de cette date, les régions pourront choisir entre une attribution directe ou une ouverture à la concurrence par appel d’offres.
Si François Hollande a respecté sa promesse de donner l'initiative de la mise en concurrence des TER aux régions, celle-ci pourrait ne pas voir le jour avant un moment. Le 8 octobre 2015, les ministres européens ont fixé à 2026 l’ouverture à la concurrence des TER. A l’issue de cette date, les régions pourront choisir entre une attribution directe ou une ouverture à la concurrence par appel d’offres.
Le 11 mars 2014, le président de l'Association des régions de France Alain Rousset avait préconisé de rester sur le calendrier initial : ouverture à la concurrence en 2019, avec des expérimentations d'ici là. Christian Estrosi, le président de la région PACA, s'est notamment porté volontaire pour une expérimentation dès la fin 2019, mais la loi le permettant n'a pas encore été votée.
Les expérimentations annoncées pour 2014 par la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet sous le quinquennat Sarkozy n'ont en tout cas pas eu lieu.
La mise en concurrence des TET
 L'accord de l'automne 2015 des ministres européens sur la libéralisation du rail prévoit une ouverture à la concurrence des trains d’équilibre du territoire (TET) français (Intercités, TER) à partir de 2023. A compter de cette date, les régions devront attribuer les lignes de train en respectant les règles des appels d'offre, et donc pas forcément à la SNCF.
L'accord de l'automne 2015 des ministres européens sur la libéralisation du rail prévoit une ouverture à la concurrence des trains d’équilibre du territoire (TET) français (Intercités, TER) à partir de 2023. A compter de cette date, les régions devront attribuer les lignes de train en respectant les règles des appels d'offre, et donc pas forcément à la SNCF.
Toutefois, il est prévu que l'Arafer (le gendarme du rail) puisse intervenir si la mise en concurrence des lignes à grande vitesse affecte "substantiellement" l'équilibre économique des lignes conventionnées.
La convention collective du transport ferroviaire
 Elle a été approuvée par les principales organisations syndicales et le gouvernement le 21 mai 2015.
Elle a été approuvée par les principales organisations syndicales et le gouvernement le 21 mai 2015.
Les autorités décentralisées
 Les articles 51 et 52 de la loi relative à "la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles" (MAPAM) adoptée le 27 janvier 2014 remplacent les anciennes autorités organisatrices de transport urbain (AOTU) par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant des compétences élargies (optionnelles) au-delà des transports collectifs urbains de personnes comme l’autopartage, le co-voiturage, la location de vélos ou la logistique urbaine. C’est le versement transport qui doit les financer les AOM.
Les articles 51 et 52 de la loi relative à "la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles" (MAPAM) adoptée le 27 janvier 2014 remplacent les anciennes autorités organisatrices de transport urbain (AOTU) par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant des compétences élargies (optionnelles) au-delà des transports collectifs urbains de personnes comme l’autopartage, le co-voiturage, la location de vélos ou la logistique urbaine. C’est le versement transport qui doit les financer les AOM.
Les prérogatives des AOM sont à nouveau élargies dans le cadre de la l’article 18 de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) adoptée le 7 août 2015. Les villes de plus de 100 000 habitants peuvent gérer les transports non-urbains et les AOM confirment la suppression des Périmètres de transport urbain (PTU). Les transports routiers sont eux co-gérés par les régions et les AOM.
Une ressource fiscale pour les régions
 La réforme ferroviaire de 2014 avait créé un versement transport intersticiel (VTI) dû par les entreprises pour financer les régions. Mais il a été abrogé par le Parlement avant même d'entrer en vigueur.
La réforme ferroviaire de 2014 avait créé un versement transport intersticiel (VTI) dû par les entreprises pour financer les régions. Mais il a été abrogé par le Parlement avant même d'entrer en vigueur.
En juin 2016, l’Acte II de la plateforme Etat-Régions prévoit 600 millions d'euros de recettes, en faveur de l’autonomie des régions dans la gestion feroviaire :
- Le gouvernement promet de saisir de créer une nouvelle taxe spéciale d’équipement régional... mais l'abandonne quelques mois plus tard.
- L’Etat instaure "un volet régionalisé de 500 millions d’euros" dans le programme d’investissement d’avenir (PIA3).
- L’Etat promet de s’engager à un effort supplémentaire dans les clauses de revoyure des contrats de plan Etat/régions (CPER).
De plus, les régions disposent désormais d’une entière liberté tarifaire et pourront reprendre la gestion des trains d’équilibre du territoire.
Pas d'obligations d'Etat pour financer l'AFITF
 Dans un rapport d’août 2016, la Cour des Comptes a fustigé le rôle de l’agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf). Décrit comme une "coquille vide", l’organisme compterait une accumulation de "restes à payer" à hauteur de 11,86 milliards d’euros depuis sa création en 2004.
Dans un rapport d’août 2016, la Cour des Comptes a fustigé le rôle de l’agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf). Décrit comme une "coquille vide", l’organisme compterait une accumulation de "restes à payer" à hauteur de 11,86 milliards d’euros depuis sa création en 2004.
L’Afitf est chargée de porter les investissements pluriannuels de l’Etat pour les nouvelles routes, autoroutes, voies fluviales et ferroviaires, et notamment les lignes à grande vitesse.
La Cour des Comptes a également dénoncé le fait que l’Afift, qui compte 4 salariés, dépende directement du ministère des Transports. L’agence est principalement financée par des taxes sur les autoroutes, sur le carburant ou les bénéfices des amendes radars Après l’abandon de l’écotaxe, les besoins de financement de l’Afitf se sont accrus, sans mise en place d’obligations d’Etat comme promis.

Calendrier respecté
Type de promesse : Engagement écrit de campagne
Mots-clés : TrainTransportstransports en communréforme ferroviaireFrédéric Cuvillier